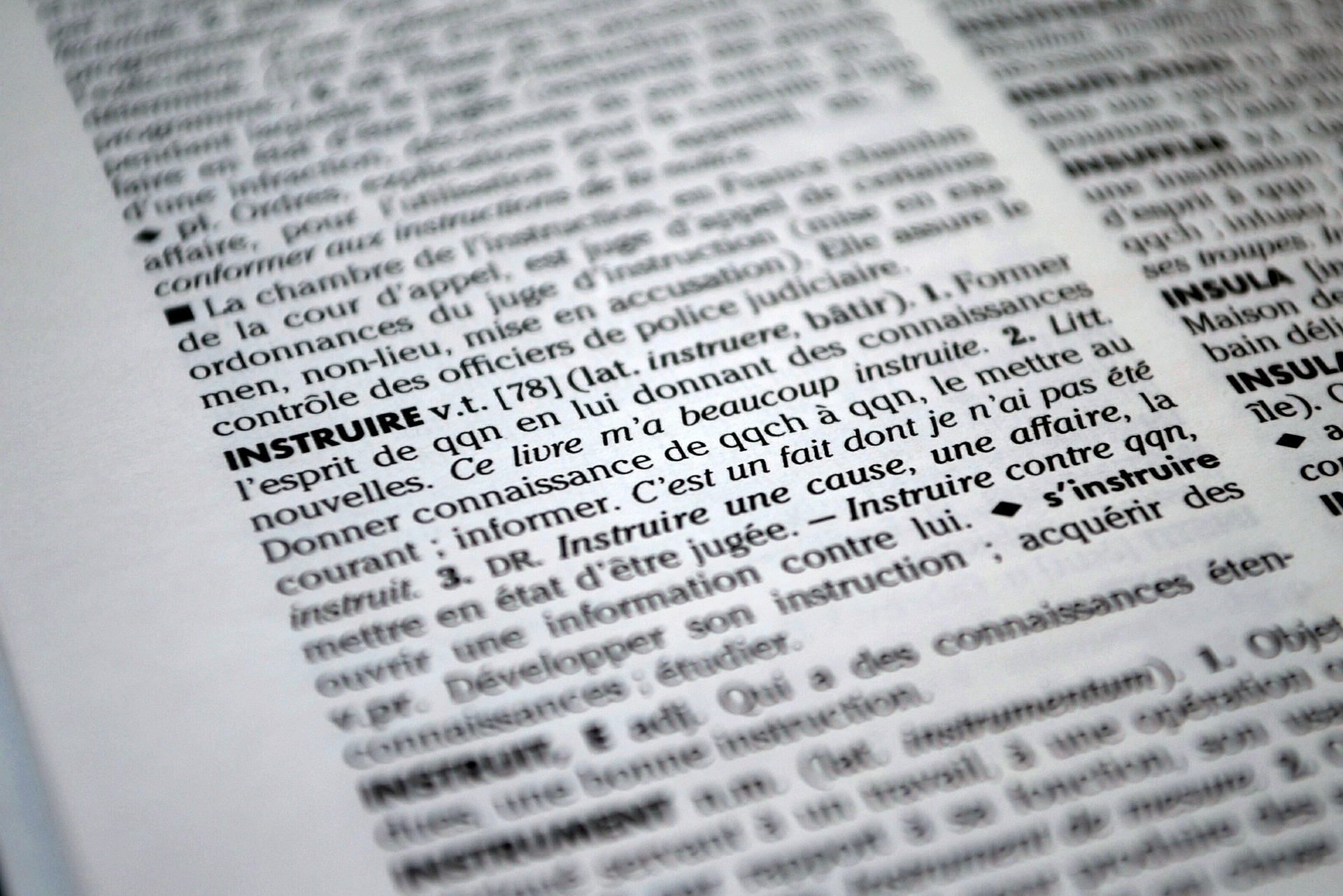
Il y a presque 16 ans, en décembre 2004, le monde entier apprenait un mot : tsunami. L’Indonésie était frappée de plein fouet par cette vague géante qui atteignait les 30 mètres par endroit. Plus de 250.000 personnes ont disparu suite à cette catastrophe.
Tsunami … Il est difficile d’imaginer que ce mot ait pu n’être connu que de très peu de personnes. Pourtant, c’était bien le cas. Ce mot était rare, réservé aux « cultivés » qui aiment les termes compliqués et peu usités. Aujourd’hui, il fait partie du langage courant. Peut-être retournera-t-il dans l’oubli … il regagnera les abysses littéraires où il attendra une nouvelle occasion de faire parler de lui. On ressortira les textes et poèmes de l’époque … on relira ce poème de 2004, écrit par Gérard Cazé :
Ce n’est qu’un tremblement, qu’un soupir de planète,
Rien de considérable aux yeux de l’univers.
Mais il a, d’un assaut, sans tirer la sonnette,
Entre deux réveillons, mis le monde à l’envers.
Du tréfonds de l’abysse, une vague omnivore,
Fruit du feu de l’enfer a quitté le foyer.
De deux à trois cent mille, on ne sait pas encore,
Plusieurs points de la carte ont même été rayés.
Sur une liste noire, empreinte d’amertume,
On dénombre les corps que l’on a retrouvés.
Sur une autre, on relit, mais l’espoir se consume,
Les noms des disparus que la plume a gravés.
Ce n’est qu’un tremblement, qu’un sanglot de la terre,
Qu’une larme au regard des frasques des humains,
Qui demain se tueront à repartir en guerre
En oubliant qu’hier ils se tendaient la main.
A chaque catastrophe son ou ses maux … et mots. Ainsi, en 2020, notre vocabulaire s’est tristement enrichi de différents termes : pandémie, confinement, déconfinement, reconfinement, cas contact, distanciation physique ou sociale, bulle sociale, asymptomatique, R0, comorbidité, … et d’autres remontent à la surface, chargé d’un passé terrible, tels que couvre-feu. Selon une récente étude, le Coronavirus pourrait avoir un impact néfaste sur nos fonctions cognitives. On parle de 8 points de QI en moins sur les personnes atteintes de la Covid-19 (oui, on dit bien « la » covid puisque cet acronyme est composé de maladie du corona virus (COrona VIrus Disease, en anglais) maladie étant un mot féminin, le néologisme qui en découle l’est aussi). La baisse de QI serait donc accentuée par cette maladie … heureusement qu’elle nous apprend moins des nouveaux mots … peut-être cela compense-t-il ?
Mais que nous disent ces mots, justement ? Comme l’expliquait Claude Askolovitch dans sa revue de presse du 29/10/2020, sur France Inter, le mot confinement vient de confins. En creusant un peu plus le sujet, je vois qu’il est composé de « con », qui veut dire « avec », et de « fin » … « finis » en latin, qui définit une limite. Aller au bout d’un processus ou d’un territoire pour être « avec », pour se rapprocher d’une ou plusieurs personne(s). Ce mot qui semble nous isoler a pour but, selon son étymologie, de nous rapprocher. Paradoxe ? Peut-être pas. Et s’il nous fallait effectivement aller au bout de l’isolement pour mieux se retrouver ensuite ? Éprouver pleinement cette période étrange, aller à l’extrême limite de notre bataille contre elle pour, ensuite, vivre plus proches encore. Le confinement n’est pas un état, c’est une action … c’est l’exhortation lancée par nos dirigeants et autres « sachants », à nous conscientiser, nous bouger et, au final, à être les acteurs efficaces de la lutte contre la pandémie. On se croit empêchés alors que, au contraire, nous sommes mis à contribution. Les mots, décidément, en disent bien plus qu’on ne le croit.
Vincent
Image par sauvageauch0 de Pixabay

